En 2020, Arcadie fêtera ses trente ans. L’entreprise qui commercialise des épices et aromates à la marque « Cook » se situe à Alès, dans les Cévennes, où elle occupe un très beau bâtiment bioclimatique. À l’entrée, une micro-crèche et un chemin bordé de plantes aromatiques. Nous allons à la rencontre d’une équipe d’une centaine de personnes récemment formées à un système de gouvernance basé sur l’intelligence collective, l’holacratie. Une nouvelle génération est aux commandes et l’ambiance est foisonnante !

© Maxime Beaufey
Arcadie est née du retour à la terre de Bernard et Dominique Kimmel, en 1978. Mû par un ras-le-bol écolo, le couple s’installe dans les Pyrénées pour y cultiver des plantes médicinales. Plusieurs étapes se succèdent : création d’un groupement de producteurs, d’un syndicat, d’un cahier des charges de culture des plantes médicinales en agriculture biologique, d’une coopérative réunissant une douzaine de familles… Pour l’époque, ce sont de véritables marginaux ! La production des plantes débute, le groupe expérimente des séchoirs solaires, adhère à Nature & Progrès, met en place une traçabilité… Les conditions de vie sont dures, pour ne pas dire misérables. En 1990, la coop devient SCOP Arcadie pour pouvoir acheter des plantes à d’autres producteurs. Nous sommes dans un monde où les épices certifiées bio n’existent pas encore. C’est Arcadie qui importe les premières épices bio en Europe, en aidant un producteur malgache à faire certifier sa production. Le succès commercial est au rendez-vous et le véritable métier d’Arcadie se précise : une capacité à trouver, partout dans le monde, des épices et aromates de qualité bio. Au début des années 2000, Arcadie se penche sur la question du commerce équitable et participe à la création du label Bioéquitable, devenu aujourd’hui Biopartenaire. Notre sujet du jour…
Entretien – Bernard Kimmel
La mise en place d’un label bio et équitable
Comment vous est venue l’intuition de lier bio et commerce équitable ?
Au début des années 1990, notre activité sur les épices nous a menés vers des pays très peu développés, en l’occurrence Madagascar, qui se situe très bas sur l’échelle des richesses. Nous arrivions après une longue période de colonisation de ce que l’on nommait alors le Tiers-Monde, et il y avait toujours le risque d’être pris dans le piège de relations inéquitables. Or nous voulions être facteur de développement, pas d’exploitation. Dès le début, il y a eu comme une évidence à montrer quel type de relation nous avions avec nos fournisseurs là-bas.

Mami, producteur de curcuma à Madagascar © YPS
Pourquoi avoir créé un label particulier ?
De la même façon qu’il ne suffit pas de s’autodéclarer « bio », un système de labels et de contrôles par des organismes indépendants permet de garantir la relation équitable. Au début des années 2000, nous avons fait des recherches sur les labels existants en la matière. Max Havelaar pointait tout juste le bout de son nez. Dans le monde du bio, les choses se sont mises en place grâce aux initiatives de gens comme André Deberdt (Kaoka) ou Didier Perréol (Priméal), qui avaient des projets de filières dans des pays du Sud. Plusieurs entreprises se sont alors groupées pour mettre en place une approche différente de celle de Max Havelaar, dans laquelle l’entreprise soit pleinement actrice. Elles ont fondé l’association Bioéquitable et le label du même nom, certifié par Ecocert. Il faut noter à ce niveau que le contrôle de l’équitable est beaucoup plus complexe que celui du bio, car il oblige à rentrer dans des questions humaines autant que techniques. Bioéquitable (réservé aux relations Nord-Sud) s’est adjoint Biosolidaire (Nord-Nord) puis est finalement devenu Biopartenaire.
Qu’est-ce qui distingue Biopartenaire des autres labels de commerce équitable ?
C’est un prêtre ouvrier néerlandais qui a eu l’idée géniale, à la fin des années 1980, de créer le label Max Havelaar. Celui-ci oblige les entreprises à remplir un certain nombre de critères, à commencer par l’achat à un prix minimum et l’octroi aux producteurs d’une prime de développement. L’association Max Havelaar agit un peu comme une ONG humanitaire qui se pose en tierce partie pour aider les producteurs à s’organiser et à vendre à un prix acceptable. Or dans cette construction-là, l’entreprise n’est pas forcément engagée dans une relation durable avec les producteurs. Celle-ci est pourtant cruciale pour que ces derniers vivent un peu plus sereinement. Bioéquitable est né du constat que les entreprises peuvent être partie prenante d’un projet de développement visant à aller vers plus de qualité, de performance et d’amélioration de la situation des producteurs. Biopartenaire demande à l’acheteur un engagement minimum de 3 ans sur les volumes et les prix d’achat. Pour la plupart des entreprises impliquées dans le label, ce sont des relations commerciales qui durent depuis dix ou quinze ans, avec des collaborations pour améliorer les techniques, introduire de nouvelles variétés… Enfin, le label Max Havelaar n’implique pas le bio. Biopartenaire est à ce jour le seul label qui garantisse les deux aspects : équitable et bio.
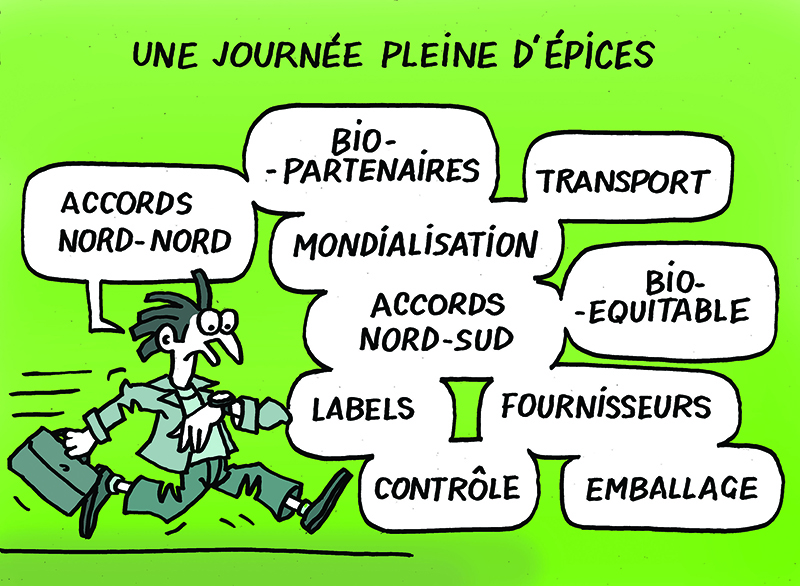
Les relations Nord-Nord
 Comment le label s’est-il étendu aux relations commerciales Nord-Nord ?
Comment le label s’est-il étendu aux relations commerciales Nord-Nord ?
C’est arrivé à peu près en même temps que la crise financière de 2008, qui a fait l’effet d’une douche froide par rapport au mythe d’une mondialisation qui apporterait le bonheur… Se sont ajoutés à cela des scandales agroalimentaires montrant que si les circuits sont trop longs et compliqués, on peut avoir des problèmes de qualité et de prix (le lait et la viande en ont été les exemples). Les agriculteurs, qui détruisaient leur vie et leur santé, sont sortis dans la rue. Certains d’entre eux se donnaient la mort. C’était presque ce que l’on décrivait sur les pays du Tiers-Monde… L’intérêt pour le local a émergé de cette crise : les gens ont réagi en souhaitant des relations de proximité et plus de justice dans les rapports économiques, en réaction à une mondialisation qui exploitait des personnes, posait de gros problèmes écologiques et supposait que des régions rurales proches de nous étaient en train de mourir. C’est là que l’on a choisi d’appliquer chez nous le savoir-faire engrangé grâce au commerce équitable Nord-Sud.
Quelles sont les différences fondamentales entre les modèles Nord-Sud et Nord-Nord ?
Il faut s’adapter à des enjeux différents. À Madagascar, la gestion du fonds de développement est un élément fondamental de la confiance que l’on établit avec nos partenaires. Avec des budgets pas si colossaux, on les aide à faire des bonds de géant en termes d’infrastructures, d’éducation… qu’ils choisissent eux-mêmes. En France, l’urgence n’est pas là. Ce que veut le producteur français, c’est un prix de vente qui lui permette de vivre correctement. Le cœur du dispositif, ce sont la prise en compte des coûts de production et l’engagement sur la durée. Il y a chez nous des questions de terroirs, des situations sociales et géographiques différentes : des montagnes, des plaines, des situations foncières favorisées et d’autres non… On est donc « dans la dentelle » pour construire des relations économiquement durables qui satisfassent les producteurs.
Par exemple ?
Un des premiers projets Biopartenaire français a été mis en place avec la SICARAPPAM, coopérative agricole de cueilleurs de plantes médicinales et aromatiques en Auvergne avec laquelle Arcadie travaillait depuis longtemps, de manière plutôt informelle. Nous avons réfléchi ensemble au calcul de leurs coûts de production, ce qui nous a amenés à revoir à la hausse nos prix sur certaines plantes. Ces revalorisations ont permis au groupement d’améliorer la rémunération de certaines récoltes auprès de leurs autres acheteurs. Tout ce travail d’échanges et de connaissances mutuelles qui se tissent à force de visites les uns chez les autres est très important : l’entreprise devient un peu un paysan, et le paysan comprend mieux comment fonctionne une entreprise. Ce projet en est à son troisième cycle d’engagements de 3 ans. Aujourd’hui, la SICARAPPAM est même représentée au conseil d’administration de l’association Biopartenaire, elle est actrice dans la démarche en plus d’être certifiée, ce qui est formidable.
La transition écologique

Yoachim et Cécile, salariés de la ferme d’Arcadie
Comment envisagez-vous la question de la transition écologique au sein d’Arcadie ?
La bio est née du constat d’un effondrement écologique, mais je crois que personne n’avait imaginé que c’était aussi proche. Il y a quarante ans, on constatait déjà une dégradation des terres, mais nous n’observions pas encore l’aspect dérèglement climatique. Se dire qu’on est à ce point capable de changer le climat, c’est assez vertigineux… Cela pose un point d’interrogation sur la survie de la Terre en tant que rare planète où il y aurait de la vie, on se dit « ouh là ! ». Et se pose la question de l’urgence. Tant qu’on n’est pas dans l’urgence absolue, on se dit « chacun va faire ce qu’il peut là où il est ». Pour moi par exemple, la problématique consistait à trouver un système agricole qui évite l’usage de biocides. Mais maintenant, on se dit qu’il faut tout réinventer. Les emballages, les transports, le numérique, tout… Au niveau d’Arcadie, c’est la deuxième génération, celle de nos enfants, désormais aux commandes, qui se saisit de cela et qui est très consciente de l’urgence. Nous sommes particulièrement concernés car nos produits ont beaucoup d’emballages. Avant, nous mettions les épices dans des flacons en verre, maintenant c’est du plastique (PET). Même si l’on explique que globalement, ce dernier a moins d’impact carbone que le verre, le plastique n’est pas une bonne chose. On avance donc vers un système de recharges, puis certainement un modèle de distribution en vrac pas évident à mettre en place mais actuellement à l’étude.
Qu’en est-il du transport des épices ?
La problématique pétrolière va nous confronter à un nouveau modèle de fonctionnement. Actuellement, on fait venir des épices et aromates du monde entier. Certaines pourraient être produites ici. Si on ne l’a pas fait jusque-là, c’est pour une question de prix et d’absence de production structurée. Forts de notre historique de producteurs, nous avons choisi de travailler à une relocalisation de la culture des plantes typiques du pays méditerranéen. En 2008, Arcadie a contribué à relancer une filière régionale de plantes aromatiques. Il a fallu à peu près dix ans pour arriver à structurer une association d’une trentaine de producteurs avec qui nous passons des contrats Biopartenaire. Nous avons également mis en place une ferme à quelques kilomètres d’ici, sur laquelle nous cultivons thym, romarin, sarriette, sauge… Toute une partie de l’économie doit se redévelopper en local : même si le blé ukrainien est moins cher, il faut essayer de consommer le blé d’ici ! Je vois mal un modèle qui continuerait à être hyper mondialisé et où les marchandises passeraient toujours leur temps à sillonner la planète. Les épices apportent un message, celui de climats qui ne sont pas les nôtres, avec une forte présence de la chaleur et de la couleur. Visiblement, nos organismes aiment cela ! Il s’agit ensuite de le mettre en musique avec nos bases à nous. Notre mission, c’est de rendre notre lieu de vie le plus nourricier possible, avec des paysages beaux, une nature luxuriante, vivante, diverse et nourricière.

 Biopartenaire peut-il participer à l’émergence de ce nouveau monde ?
Biopartenaire peut-il participer à l’émergence de ce nouveau monde ?
Biopartenaire est une démarche de mutation culturelle et civilisationnelle, plus qu’un argument commercial – dont on ne sait même pas s’il rapporte quelque chose, tant il est encore peu identifié par les consommateurs ! Je suis devenu chef d’entreprise sans l’avoir voulu, pour soutenir le développement de la bio. Le commerce équitable est venu comme une suite logique. Biopartenaire a fait un gros travail pour spécifier les rôles de chacun dans la chaîne alimentaire, en partant du producteur et en passant par tous les maillons nécessaires de la filière pour arriver jusqu’au consommateur. Aujourd’hui, on pointe le rôle du distributeur, comme Satoriz, qui a un pouvoir de choix des produits et de communication en direction du consommateur. Synadis bio, le syndicat des distributeurs de produits bio français, vient de signer son adhésion à Biopartenaire. Cet acte est porteur de beaucoup de perspectives. Le magasin bio spécialisé peut porter le projet, y réfléchir avec nous… La situation est trop grave pour que l’on s’interdise de s’élever un peu et de réfléchir collectivement. C’est même de plus en plus passionnant !
CC

